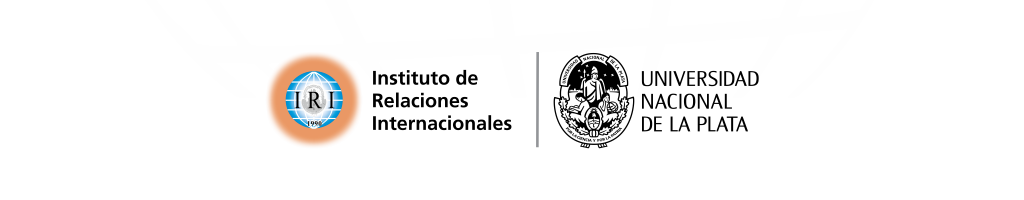Departamento de Derecho Internacional
Artículos
Habitar la tierra de otra manera…
Hacia un nuevo derecho internacional biocéntrico basado en los seres vivos
Emmanuelle Tourme Jouannet [1]
Pouvez-vous définir ce que vous appelez une vision anthropocentrique du monde ?
Une vision anthropocentrique est une représentation du monde où l’espèce humaine est à la fois différente et supérieure à l’ensemble des autres vivants et espèces. C’est cette vision qui est aujourd’hui au fondement de toutes nos catégories socio-culturelles et donc du droit international contemporain. L’être humain est la mesure de toute chose et seul digne de considération en soi. Cette séparation entre l’homme d’un côté et le vivant et la nature de l’autre côté, a généré une attitude de domination de l’homme envers la nature et les animaux qu’il a rabaissé au rang de simples choses existant pour sa propre utilité et n’ayant aucune valeur en soi. C’est la raison pour laquelle les animaux, par exemple, dont on sait aujourd’hui qu’ils sont pourtant des êtres sentients doués de sensibilité mais également d’agentivité, sont encore traités et utilisés comme des objets, des choses à produire de la viande du lait ou de la fourrure pour les êtres humains. Dans une telle vision du monde, seul l’être humain (ou les sociétés humaines comme les Etats ou les organisations internationales) sont définis comme des sujets de droit international pouvant être acteurs du droit et bénéficier de droits fondamentaux.
Cet anthropocentrisme juridique, issue du faux dualisme nature/humain, a été transposé au droit international dès le XVIIIème siècle avec les Lumières européennes. On a théorisé l’idée que l’homme ne pouvait accomplir sa pleine humanité qu’en se détachant du monde naturel et on a transposé cette idée aux Etats comme sociétés humaines devant se couper de la nature pour accomplir leur propre perfection d’Etat. D’où l’émergence d’un droit international entre Etats comme étant anthropocentrique lui aussi. Cette vision anthropocentrique s’est amplifiée au XIXème siècle avec les révolutions industrielles et les immenses colonisations européennes qui ont conforté l’être humain dans sa toute-puissance. Elle a été relancée après la Seconde Guerre mondiale et culmine aujourd’hui, avec la mondialisation, à travers un système juridico-économique d’exploitation à outrance des ressources de la planète, un système légalisé par le droit international. Notre droit international économique, qui est le lointain produit de la prétendue coupure anthropocentrique avec la nature, et qui voulait ainsi faire de nous de véritables êtres humains, est en réalité un ensemble de discours et de normes qui, dans sa version actuelle, conduit au contraire à déshumaniser les humains, à les chosifier tout comme il a contribué, par ses catégories juridiques, à chosifier le vivant et la nature avant l’homme.
Toutefois, on a aussi commencé, dès les années 1970, à réaliser les implications catastrophiques pour la planète et pour nous tous qui l’habitons, humains et non-humains, de ce système et d’un droit international qui le cautionne complètement. Aussi a-t-on parallèlement établit des normes et des discours juridiques internationaux visant à combattre les conséquences de ce système et à lutter contre le crise climatique. On a notamment adopté des centaines de conventions internationales pour protéger l’environnement, assurer un développement durable pour les futures générations et mettre fin à la crise climatique majeure ainsi que celle de la biodiversité (la multiplicité des espèces vivantes, animales et végétales) que nous traversons. Autrement dit, on est face aujourd’hui à un droit international, qui reste anthropocentrique, mais qui est beaucoup plus hétérogène que par le passé car il inclut à côté d’un droit international économique destructeur de la nature et du climat, un droit de l’environnement et du développement durable qui vise à lutter justement contre ses effets délétères.
Mais, alors, en quoi le nouveau droit international écologique biocentrique, que vous proposez dans votre livre, est-il différent du droit de l’environnement actuel qui vise également à protéger la nature et à lutter contre la crise écologique ?
Le droit international contemporain de l’environnement repose lui-aussi entièrement sur cette vision anthropocentrique du monde c’est-à-dire qu’il est centré sur l’être humain et la préservation de son environnement. Dans ce cas, la nature et les vivants ne sont qu’un « environnement » à protéger au service de l’homme et de ses finalités. Ils restent aux yeux de tous comme des choses inertes, de simples ressources à la disposition de l’être humain, quand bien même on cherche désormais à les exploiter de façon durable et responsable. C’est donc un droit international anthropocentrique. Or ce fondement anthropocentrique du droit international de l’environnement explique le grand désillusionnement qu’il a fini par susciter, y compris chez les spécialistes de ce droit. Il contient des centaines de conventions internationales, de grands principes de droit coutumier qui vont dans le bon sens et qui peuvent, pour les plus spécifiques, apporter des solutions concrètes et prometteuses. Ainsi est-il pour la préservation des espèces animales sauvages ou la conservation des zones humides indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes vivants. Mais il n’empêche que le droit contemporain de l’environnement est, globalement, remarquablement inefficace -et je mesure mes mots- s’agissant des plus graves problèmes à affronter : limiter les gaz à effet de serre (crise climatique), empêcher le déclin des espèces vivantes (crise de la biodiversité) et préserver l’avenir des générations futures (crise touchant toute l’humanité). Il débouche sur une impasse terrible dès lors que les gaz à effet de serre continuent régulièrement d’augmenter et que l’on est à l’aube d’une 6ème extinction de masse des espèces animales et végétales. Autrement dit, malgré ce droit, nous allons directement vers la catastrophe car, selon les mots du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous continuons de mener une « guerre suicidaire contre la nature » et, ce faisant nous avons « ouvert les portes de l’enfer » que nous ne savons pas comment refermer pour sauver l’humanité et la planète.
Du reste , c’est la raison pour laquelle Antonio Guterres plaide lui aussi pour un abandon de la vision anthropocentrique du monde et un renouvellement complet des fondements du droit international. On rejette souvent avec raison sur les Etats la responsabilité de cette ineffectivité du droit international de l’environnement en raison de leur manque de volonté et de leurs divisions. Cette attitude est tout aussi insupportable qu’irresponsable. Mais il faut bien comprendre qu’en dehors de leur mauvaise volonté, les Etats eux-mêmes sont dépassés par un système international totalement contradictoire en raison de son dualisme anthropocentrique homme/nature. Ce dualisme fait que l’on a ainsi des régimes juridiques opposés ou, d’un côté on s’engage à préserver l’environnement mais d’un autre côté on favorise constamment un régime juridique économique et des investissement qui est destructeur de ce même environnement. Or, dans la très grande majorité des contentieux où le droit de l’environnement s’oppose au droit international économique et aux intérêts des multinationales, c’est le droit international économique ultralibéral qui prévaut. Le fondement anthropocentrique du droit international fait qu’il reste fondé sur une considération de la nature comme une matière inerte à la disposition de l’homme, des Etats et des compagnies privées, et donc sur un paradigme de domination et de mort du vivant, de la nature et du climat. Si bien que de façon insidieuse mais très réelle, il existe aujourd’hui au plan international/mondial, une hiérarchie des normes juridiques en faveur du droit économique au service d’intérêts privés ou publiques et en défaveur du droit de l’environnement. C’est ce que j’essaye de montrer avec des exemples de droit commercial, de droit de la propriété intellectuelle ou encore de droit privé des investissements.
Aussi bien, si on veut vraiment arriver à faire face à la catastrophe, il faut changer cela et comprendre qu’il y a une véritable crise existentielle et civilisationnelle qui va beaucoup plus loin que la seule crise climatique. On n’y arrivera pas autrement. On sera toujours prisonnier de ce paradigme de domination et de destruction. La solution est donc d’abandonner l’anthropocentrisme du droit international actuel de l’environnement en faveur d’un nouveau droit international écologique qui sera fondé sur le biocentrisme (le vivant) et une conception de l’être humain qui n’est plus amputé de sa dimension corporelle, charnelle, naturelle. Le décentrement de l’être humain au profit de la prise en compte du vivant amène ainsi à un décentrement du droit international lui-même fondé sur le principe de la cohabitation et la prise en considération de tous les vivants, humains et non humains.
L’être humain va renouer avec la nature sur le mode de la considération et non plus de la domination car il aura désormais conscience de sa parenté avec toutes les autres espèces végétales et animales. La vision anthropocentrique du monde a désancré les pieds de l’homme de la terre et de la nature en prétendant justement l’arracher à la nature pour le rendre soi-disant libre et donc pleinement humain. Mais, comme nous l’enseigne la phénoménologie de la philosophe Corine Pelluchon, cette conception mutilée de l’être humain que véhicule encore le droit international de l’environnement -et l’ensemble du droit international- est fondé sur l’oubli de la matérialité de notre existence, de notre dépendance primordiale en tant qu’être charnel, « vivant de », « dépendant de », de la nature et de toutes les autres espèces. En revanche le nouveau droit international biocentrique est fondé sur cette reconnaissance première de notre dépendance avec la nature et toutes les espèces végétales et animales (y compris les humains).
Il s’ensuit un changement de paradigme où celui de la domination et de la mort, hérité du XVIIIème siècle européen, cède la place à celui de la considération et de la vie. Le droit international écologique que j’appelle de mes vœux, repose sur ce nouveau paradigme, c’est-à-dire sur une représentation biocentrique du monde où tous les vivants, humains et non humains, où la nature elle-même ont une valeur en soi. De ce fait les règles du droit international écologique amèneront à une autre façon d’habiter la Terre de telle sorte qu’elle soit inévitablement préservée ainsi que l’humanité. C’est un droit international des interdépendances entre les vivants, humains et non humains où, certes, l’homme garde une importance morale supérieure mais où le droit international nous oblige à la considération de la vie car tous les êtres vivants ont une valeur en soi. Par exemple, lorsque nous pensons aux animaux, lorsque nous rencontrons ou vivons avec un animal, nous ne le voyons pas comme un objet à produire de la viande mais comme un être ayant une sensibilité et une agentivité exprimant sa valeur propre d’être vivant non humain. De même, lorsque nous nous promenons en forêt et que nous nous immergeons dans la présence, la force, l’âge et la beauté des arbres qui nous entourent, nous ne voyons pas leur valeur instrumentale comme réservoir de bois ou « usine forestière » durable, mais nous découvrons leur valeur en soi. Certes, comme l’indique Pelluchon, c’est l’être humain qui découvre, ressent cette valeur du vivant (fonction anthropogénique mais non pas anthropocentrée). Il confère cette valeur mais il ne la crée pas. Ce qui signifie que les vivants non humains, toutes les espèces animales et végétales, les animaux, les plantes, les rivières, les forêts, les montagnes et tous les écosystèmes ont une valeur propre, digne d’être prise en considération et qui excède leur valeur instrumentale.
Cela reviendrait donc à accorder des droits aux animaux et à la nature de la même façon que l’on accorde aujourd’hui des droits à l’être humain ?
Oui tout à fait. Mais c’est un point très important qui doit être bien expliqué. D’abord, il existe déjà de nombreux exemples dans le monde, plutôt non européen, où les cultures traditionnelles comme en Asie ou en Amérique du Sud amènent beaucoup plus facilement à le faire. Je détaille dans mon livre ces exemples concernant des éléphants, des fleuves, des rivières ou des forêts. Mais, ensuite, je tente aussi de montrer que l’on se méprend souvent sur les conséquences d’un tel droit international biocentrique qui accorde des droits aux espèces vivantes. Il y a beaucoup de malentendus que, là encore, j’essaye de dissiper à la suite de Pelluchon. Par exemple, reconnaître en droit la nécessité d’une égale prise en compte des intérêts des animaux ou des fleuves ne veut absolument pas dire qu’il y a égalité de droits entre eux et les êtres humains ni qu’ils ont la même importance morale. On reconnait des droits qui sont déduits des normes de comportement ou des cycles de régénération des vivants, animaux, fleuves, glaciers, barrière de corail etc. Mais on ne les déclare pas égaux en droit aux êtres humains qui se distinguent toujours par leur liberté morale et leur capacité à faire des choix argumentés ; et donc aussi par leur responsabilité envers la nature. Il n’y a donc aucun antihumanisme juridique dans le fait de défendre un ordre juridique international écologique. Je ne peux tout développer ici mais je consacre une bonne partie de mon livre à expliquer cela ; et à défendre ce que j’appelle, à la suite de Pelluchon, de nouvelles Lumières ou Les Lumières écologique où les droits de la nature viennent renforcer les droits de l’être humain et non pas prévaloir sur eux.
Dans la foulée, j’essaye également de dissiper le malentendu selon lequel un tel droit nous ramènerait à l’âge des cavernes ou essayerait de nous transformer en « peuples de la forêt » comme le sont les communautés autochtones amazoniennes. C’est complètement faux. Un tel droit international écologique ne renie ni la science ni la technique qui ont permis d’accomplir des prodiges pour l’humanité. Cependant, les sciences comme la technique doivent être encadrées juridiquement de telle sorte qu’elles ne soient plus au service d’un ordre juridique international économique oublieux des fins humaines et du vivant, mais au service du nouveau droit international écologique. Elles doivent retrouver leur sens originaire qui est celui de permettre de bien administrer notre maison commune qu’est la Terre et d’assurer le bien-être de tous ses habitants, humains et non humains. Du reste, je n’invente rien en disant cela : très nombreux sont ceux qui dénoncent avec force ce système économique ultra libéralisé. Mais en vain comme en attestent de multiples contentieux d’investissements où l’économique l’emporte quasiment toujours sur les droits humains et les droits de la nature. Or c’est malheureusement logique car, justement, cela ne peut se faire en restant dans le paradigme actuel anthropocentrique. Il nous faut procéder à une reformulation entière de notre rapport aux vivant, aux droits de la nature, qui, seule, peut permettre de réellement repenser l’économie.
Mais, concrètement quelles sont les effets pratiques pour la protection de la nature et de l’être humain ?
En dehors même d’une position éthique qui revalorise l’insertion de l’humain au sein de la nature, ce nouveau droit international écologique permet de préserver beaucoup mieux la nature, et donc de lutter beaucoup plus efficacement contre le dérèglement climatique et le déclin de la biodiversité. Ce qui, par voie de conséquence, est donc, en plus, la solution juridique à long terme pour que l’humanité évite toute crise semblable à celle que nous traversons. En devenant sujets de droit par le biais d’une personnalité juridique non humaine, les lacs, océans, animaux, montagnes, les forêts, la prairie devant chez moi, la rivière qui coule à travers votre village, les arbres et les oiseaux qui cohabitent avec vous en ville, mais aussi, bien sûr, les espèces « moches », les espèces « sauvages », les « invasives », les glaciers, tout ce monde pleinement vivant, ayant son propre mode de fonctionnement et qui n’était pourtant qu’une « collection d’objets », tous ces vivants pourront alors devenir des acteurs juridiques dans le sens où le passage du statut d’objet à celui de sujet, de chose à celui de personne non humaine, leur ouvre l’accès à la vie juridique. Ils deviennent des acteurs du droit et font partie intégrante des relations humaines via leurs représentants humains. Par exemple, si leurs droits sont violés du fait de l’activité polluante d’une grande ou petite entreprise, leur représentant humain ou mandataire (désigné à l’avance) pourra défendre directement leurs droits en recherchant, d’abord, un compromis à l’amiable avec le pollueur, et si jamais il ne peut y avoir de compromis, il pourra saisir une autorité publique, administrative, ou un juge à qui il demandera une mise en responsabilité et une réparation pour les dommages qui leur auront ainsi été directement causés en tant qu’entités vivantes, ayant une valeur en soi.
Attention, ne nous méprenons pas : il ne s’agit évidemment pas de verser dans un pan-juridisme consistant à reconnaitre des droits à ces milliards d’espèces, mais d’ouvrir la possibilité, au cas par cas, de leur conférer des droits et un représentant afin de les défendre directement devant un tiers.
Mais, à vrai dire, un tel droit et une telle vision semblent d’une certaine façon, excusez-moi de le dire, impensables ou absurdes au regard de ce que nous avons l’habitude de croire. Sur quoi vous fondez vous pour dire ainsi qu’un nouveau droit international écologique devrait nous amener à reconnaitre ces droits de la nature à côté de ceux des êtres humains et des Etats ?
Nous sommes tellement imprégnés d’une représentation anthropocentrique du monde que l’on ne peut arriver, ne serait-ce qu’à imaginer cette autre façon de le penser. Notre vision du monde entièrement centré sur l’individu (et l’Etat) comme seuls vrais sujets de droit nous conditionnent complètement et il est extrêmement difficile de s’en défaire et de voir les animaux et les plantes comme des êtres pleinement vivants, et donc comme des sujets et non des objets du droit. D’où le reflexe courant de dire que c’est inepte. Et c’est très dur, je le reconnais tout à fait, d’abandonner cette façon de penser car cela nous amène à penser contre un inconscient collectif nourri par des siècles d’anthropocentrisme. Toutefois cela n’a rien d’absurde ni d’impensable, loin de là ! Pour le prouver, je m’appuie sur trois arguments principaux.
Tout d’abord, l’ensemble de ma pensée du droit international repose sur les travaux remarquables de la phénoménologue française Corine Pelluchon, une de nos philosophes les plus lues à l’étranger. A mon avis, ces travaux forment un tournant dans la pensée occidentale du droit car ils nous donnent les clefs pour penser le monde « d’après » et une civilisation nouvelle. Grâce à eux on réalise que cette objection du caractère absurde ou inepte d’une telle vision juridique biocentrique du monde témoigne plutôt de la persistance mortifère d’une véritable cécité à l’égard de ce qui nous constitue en tant qu’être humain corporel, engendré, « dépendant de », et relié, par sa condition charnelle d’être vulnérable, à toutes les autres espèces qui peuplent la Terre. Elle explique également, par là même et par voie de conséquence, l’état d’engourdissement moral de l’humanité face aux souffrances atroces que peuvent subir certains humains et non humains, face à la faim et la pauvreté dans le monde, aux inégalités insupportables liées à la mondialisation ultralibérale ainsi qu’à la destruction catastrophique de la nature et du vivant.
Ensuite, je rappelle que notre pensée occidentale de l’être humain comme étant seul titulaire de droits et coupé d’une nature considérée comme une simple ressource, n’est absolument pas partagée par toutes les régions et les peuples du monde. Il existe de très nombreuses populations paysannes, des traditions particulières, des religions pour qui la vision biocentrique du monde est beaucoup plus évidente que celle de l’anthropocentrisme.
Enfin, je reprends les travaux les plus récents des différentes sciences concernant le vivant qui viennent conforter, par l’observation scientifique et rationnelle, ce que l’on a pu démontre au plan philosophique et culturel. Parmi beaucoup d’autres, le livre d’Emmanuelle Pouydebat, intitulé ironiquement « L’intelligence animale : cervelle d’oiseaux, mémoire d’éléphant », fait le point sur les avancées de l’éthologie, la science du comportement animal. De façon passionnante et très documentée, elle montre comment tous les critères qui avaient été érigés comme le propre de l’humain au regard de l’animal sont désormais remis en question par la science et notamment l’intelligence qui est la notion au cœur de son ouvrage. Dans la foulée, en 2012, treize neuroscientifiques signaient la « Déclaration de Cambridge sur la conscience », un manifeste affirmant l’existence chez les animaux non humains d’une conscience analogue à celle des animaux humains. À ce sujet le New York Times titrait avec ironie en juillet 2023 : « Ils sont plus malins que nous ». Le journal raconte le comportement de pies et de corbeaux qui ont bâti des nids à Anvers ou à Rotterdam, faits à partir d’aiguilles arrachées à des dispositifs anti-oiseaux. De telle sorte que « [l]es pies ont réussi à transformer une architecture hostile en maison ». Leurs nouveaux nids, composés d’acier, ressemblent à de petits bunkers, « tel un geste d’adversité rendu à l’envoyeur ». Comme celui des orques, qui multiplient, depuis trois ans, les attaques groupées contre des bateaux au large de Gibraltar – et qui seraient peut-être des actes de représailles à la suite d’un accident dont aurait été victime une orque matriarche, percutée par un bateau en 2020. Du reste, l’entrée en lutte de certains animaux contre l’exploitation humaine a fait l’objet d’un véritable travail d’étude à travers l’histoire mené par Fahim Amir sur les « Révoltes animales ». Il montre, par exemple, comment les porcs récalcitrants sont aux origines de l’usine moderne ou la façon dont les termites créent des sociétés « communistes ». D’autres scientifiques et éthologues ont étudié des espèces animales spécifiques qui donnent une idée des avancées incroyables de ce nouveau champ d’étude qu’est celui des « intelligences animales ». C’est ainsi que Vinciane Despret nous incite à « Penser comme un rat », ou à « Habiter en oiseau », ou encore à imaginer l’ « Autobiographie d’un poulpe », dans laquelle elle théorise la notion de « thérolinguistique », une branche de la linguistique « attachée à étudier et à traduire les productions écrites par des animaux » et par laquelle elle met en récit, par exemple, « la poésie vibratoire des araignées ». De son côté, Baptiste Morizot propose de faire des loups des « Diplomates » tandis que la philosophe Florence Burgat s’intéresse à l’Inconscient des animaux de même qu’aux normes de comportement tout à fait captivantes mais encore mystérieuses des chats dont elle livre, selon ses mots, quelques « miettes philosophiques ».
Quant aux végétaux, la recherche avance considérablement également et, par exemple, ce que l’on appelle la « linguistique des plantes » ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre à quel point le monde végétal parle et se parle. On sait désormais que les arbres ont leur propre mode de vie. Ils dialoguent tout comme l’ensemble des plantes. Une toute dernière recherche vient confirmer ce qui est déjà décrit depuis de nombreuses années. Les plantes n’ont pas d’oreilles ni d’yeux mais elles communiquent entre elles en émettant des substances chimiques que l’être humain arrive désormais à identifier et même visualiser en temps réel. Elles peuvent augmenter leur concentration en sucre afin d’attirer les pollinisateurs, émettre des sécrétions pour éviter que les insectes ne leur portent atteinte ou encore activer des défenses à l’intérieur de leurs cellules pour lutter contre leurs prédateurs, incluant les humains. En 2009, une équipe internationale a démontré que chaque plante possède des dizaines de milliers de racines qui analysent constamment les données de leur milieu. Elles sont toutes connectées entre elles et à la base de la tige, ce qui permet d’envoyer des informations vers l’ensemble de la plante, mais aussi de recevoir des signaux qui proviennent des feuilles ou des branches. Ainsi chaque plant de tomate, chaque pied de ronce, chaque orchidée ressemble à un réseau internet constitué de sites d’information reliés les uns aux autres. Non seulement les plantes ont des capacités d’apprentissage, de prise de décision et de mémorisation, mais, de plus, les expériences les plus récentes montrent qu’elles connaissent le sommeil, et que certaines sont très vraisemblablement dotées de conscience ainsi que de sensibilité à la douleur. On retrouve ainsi, par exemple, une sensibilité et une capacité d’apprentissage tout à fait particulières chez la Mimosa pudica, une étonnante anticipation du stress chez les petits pois, une somnolence comparable à la nôtre chez les haricots, un sommeil récupérateur chez le bouleau ou une mortalité de 100 % due à des légumineuses rendues insomniaques. On a identifié la capacité, que l’on croyait uniquement animale et humaine, qui est celle de se reconnaître comme tel chez l’Ambrosia du désert et de se différencier ainsi des autres, celle de favoriser ses « petits » de la part des « arbres-mères », un partage équitable des ressources en azote, carbone et phosphore chez les arbres d’une forêt primaire de Colombie britannique par le biais de champignons interconnectés (les mieux lotis en lumière aidant les moins bien lotis) ou encore une véritable mémoire chez la dionée carnivore.
Du reste, les éthologues et les biologistes feront sans doute évoluer la définition de leurs capacités au fur et à mesure qu’ils avanceront dans une meilleure connaissance des vivants non humains. Autrement dit, l’apport des sciences et des scientifiques n’a donc jamais été aussi essentiel pour analyser la situation que nous vivons et renforce sans conteste le biocentrisme au fondement d’un nouveau droit international écologique.
Vous commencez et terminez votre ouvrage par un message d’espérance. Quel est-il exactement ?
Comme tous ceux qui défendent les droits de la nature, je suis bien consciente des difficultés à faire prévaloir cette vision. Cela prendra du temps. En attendant, nous pouvons, à tout le moins adopter un « pragmatisme de combat » pour faire face à la crise en associant le droit de l’environnement actuel avec le droit international écologique des interdépendances entre les vivants. Il s’agit de mettre de côté nos prises de position éthique opposées, anthropocentrique ou biocentrique, afin d’éviter le dogmatisme sur ces questions. Il n’y a rien de pire comme attitude qui paralyse une action concertée et commune des anthropocentristes et des biocentristes. Cela permet de laisser à la subjectivité de chacun le choix en faveur de telle ou telle option éthique, et donc, pour le moment et face à l’urgence, de déplacer le débat sur le terrain des modalités rationnelles de l’action écologique.
Mais à long terme, l’espérance en faveur d’un nouveau droit international écologique vient de la certitude qu’il existe aujourd’hui un mouvement de fond de plus en plus large en faveur de l’âge du vivant et de la considération : ce mouvement, dont on voit les manifestations se multiplier à travers la planète, veut réparer notre condition humaine amputée du monde de la nature et, ce faisant, inverser la logique destructrice de notre monde actuel. J’espère qu’il va s’imposer de lui-même face aux évènements actuels. Il peut en effet conduire chacun et chacune à vivre un bouleversement, à la fois intérieur et extérieur, qui changera radicalement sa façon d’habiter la Terre. A cet égard, je voudrais citer Aldo Léopold, l’un des fondateurs de cette nouvelle façon d’envisager les relations entre l’homme et la nature, qui a été si injustement décrié en France :
« Nous abusons de la terre parce que nous la considérons comme une marchandise qui nous appartient. Lorsque nous la percevrons comme une communauté à laquelle nous appartenons, peut-être commencerons-nous à la traiter avec amour et respect. Il n’y a pas d’autre moyen pour la terre de survivre à l’impact d’un homme mécanisé ».
(Aldo Léopold, Almanach d’un comté des sables, 1948)
[1] Esta entrevista fue publicada originalmente en francés en la revista Émile & Ferdinand, número 46 (agosto) por la editorial Larcier Intersentia.